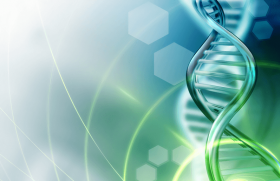Editorial
Publié le 25 juin 2024Lecture 3 min
Gloires éternelles ou idoles déchues ?
Patrice DARMON, CHU Conception, APHM, Marseille

En marketing, le biais de nouveauté se définit par notre tendance à privilégier le nouveau à l’ancien, forcément moins performant, forcément moins adapté, forcément dépassé... L’attrait irrésistible pour la nouveauté nous pousse à délaisser ce qu’on a adoré. L’innovation suscite notre curiosité et stimule notre enthousiasme… jusqu’à ce que les charmes du changement s’estompent pour laisser place, une fois de plus, à l’envie impérieuse du neuf, forcément plus efficace, forcément plus pertinent, forcément meilleur… Ces dernières années, une célèbre marque à la pomme a construit sur ce biais cognitif une implacable mécanique lui permettant d’écouler chaque année des dizaines de millions du nouveaux modèles de son téléphone phare pourtant à peine modifié par rapport à la version précédente…
En médecine, les choses sont heureusement différentes : si l’innovation thérapeutique est le plus souvent source de progrès et permet, lorsqu’elle accède au marché, d’améliorer la santé et la qualité de vie des patients, il est des gloires éternelles dont l’aura ne se dément pas en dépit du temps qui passe — aspirine, corticoïdes ou insuline en sont quelques exemples. En diabétologie, une de ces stars de la pharmacopée, la metformine, a vu son statut de pilier du traitement du diabète de type 2 remis en cause ces dernières années par quelques médecins iconoclastes (principalement généralistes ou cardiologues) au prétexte qu’elle n’avait jamais réussi à démontrer de façon formelle de bénéfice cardiovasculaire spécifique, ce qui est vrai mais occulte injustement les indiscutables avantages métaboliques et les effets pléiotropes supposés de cette vieille molécule au coût dérisoire. Fort heureusement, les sociétés savantes de diabétologie, et en particulier la SFD dans sa dernière prise de position, continuent à faire la part belle à la fringante septuagénaire dans les stratégies thérapeutiques du diabète de type 2 et ne semblent pas avoir l’intention de la reléguer de sitôt au rang d’idole déchue malgré l’avènement des jeunes séducteurs aux dents longues que sont les inhibiteurs de SGLT2 et les analogues du GLP-1.
Si l’insubmersible metformine résiste plutôt bien au biais de nouveauté, une autre icône de la diabétologie, la sacro-sainte HbA1c, commence à vaciller sur son trône. Jusque-là marqueur incontournable (et quasi monopolistique) de l’équilibre glycémique des semaines passées et critère de substitution du risque de survenue des complications microvasculaires, son statut est remis en cause par le recours de plus en plus fréquent à la mesure continue du glucose — au moins chez les patients traités par insuline — permettant d’évaluer de façon beaucoup plus fine la qualité du contrôle glycémique. Si la mesure continue du glucose permet de contourner les nombreuses situations pouvant fausser le dosage ou la valeur de l’HbA1c et de s’affranchir de la variabilité interindividuelle du processus de glycation, elle nous apporte surtout des informations cruciales que l’HbA1c est incapable de fournir : temps passé dans la cible, temps passé en hypoglycémie et en hyperglycémie ou variabilité glycémique, ces fameux nouveaux « metrics » du glucose dont Bruno Guerci et Michael Joubert nous présentent les avantages dans un excellent article de ce numéro. Pour autant, si l’arrivée des capteurs de glucose a totalement changé la donne en termes d’évaluation du contrôle glycémique et du confort de surveillance pour les patients traités par insuline et a permis une amélioration… de l’HbA1c (!) mais aussi une réduction de l’incidence des complications métaboliques aiguës du diabète, il n’existe à ce jour aucune étude d’intervention d’envergure démontrant que l’amélioration de ces « metrics » soit associée à une réduction des complications micro- ou macrovasculaires liées au diabète. Nul doute que ces essais arriveront bientôt mais pour l’heure, ces nouveaux « metrics » ne sont qu’un (précieux) complément de notre bonne vieille HbA1c qui, malgré ses limites, n’est pas encore tout à fait prête à rejoindre le cimetière des éléphants. On peut d’ailleurs s’amuser à remarquer que le remboursement des capteurs récemment obtenu pour les patients traités par une ou deux injections d’insuline par jour est subordonné à l’existence… d’une HbA1c supérieure à 8 %.
Il en va ainsi en 2024, en diabétologie comme ailleurs : certaines statues sont plus difficiles à déboulonner que d’autres !
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :